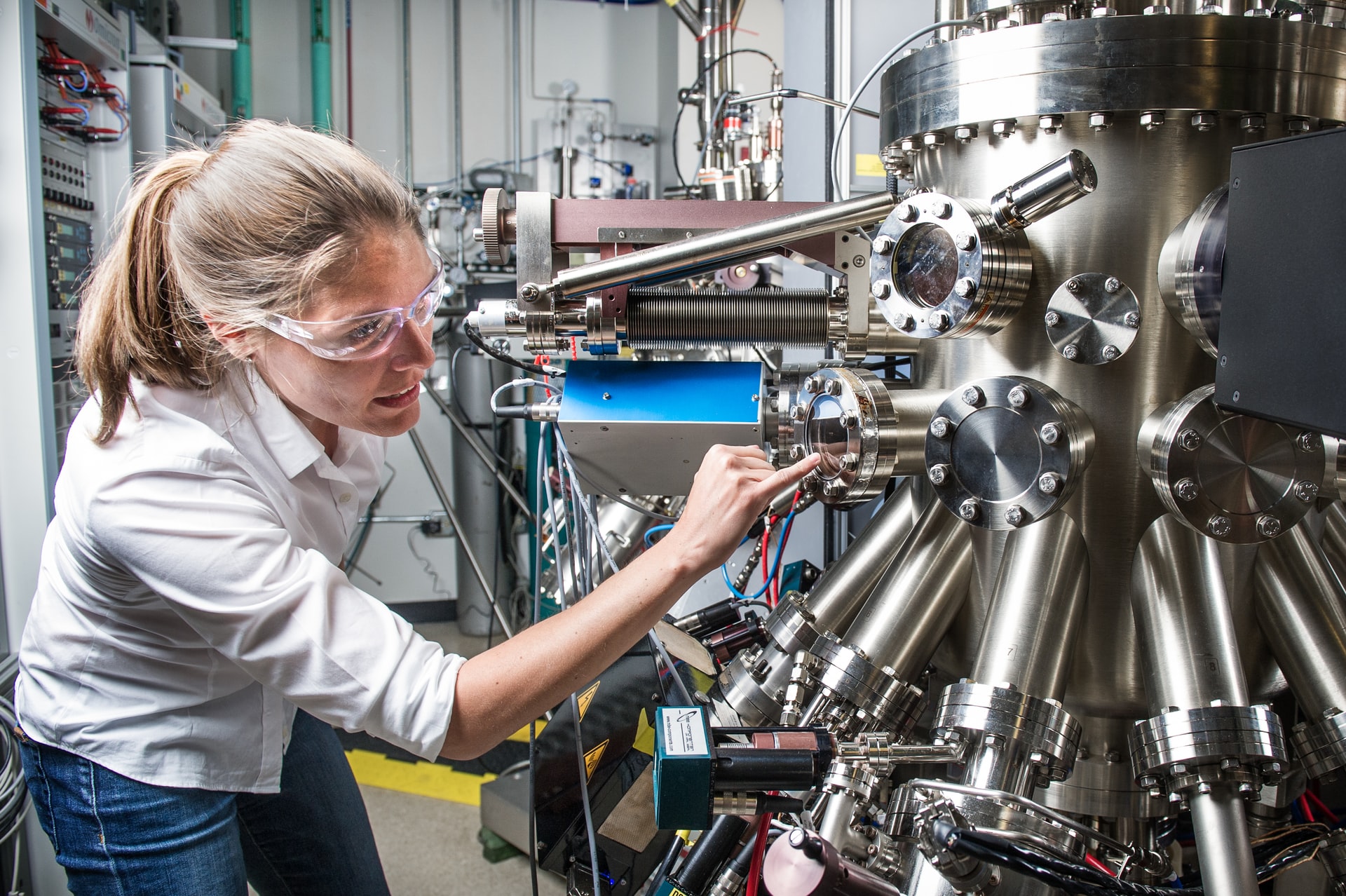Reconnaissance et dignité du travail. « Le principe de méritocratie, au coeur de notre pacte républicain, est synonyme de justice sociale et d’émancipation » est une phrase assez commune dans nos discours politiques. Si la méritocratie porte un idéal de mobilité sociale, elle est amplement conditionnée par les diplômes et les origines sociales. A la veille des élections présidentielles, il est donc judicieux de l’interroger.
Déconstruire le mérite
La méritocratie signifie littéralement le pouvoir des méritants. Ce néologisme fondé en 1958 par Michael Young dans une dystopie, The rise of Meritocracy, où la grande Bretagne est redevenue une société de castes fondée sur le mérite, correspond à un idéal plus ancien. Le mérite s’oppose au privilège et en ce sens, il est central dans la pensée américaine et française dès la fin du XVIIIème siècle. L’idéal méritocratique suppose que toute personne, si elle s’en donne les moyens et acquiert des diplômes, pourra gravir l’échelle sociale grâce à son mérite.
Toutefois, ce mérite a récemment été mis en question dans les cercles académiques et intellectuels : est-il la bonne conscience d’héritiers ? Que faire des « perdants » ? Quelle place accorder aux non-diplômés dans ce système ? Ces débats, portés récemment aux États-Unis par Sandel et Markovitz et par des énarques et des entrepreneurs en France, cherchent à distinguer qui et pourquoi est digne de récompense dans nos sociétés. Loin d’être théoriques, ils sont nourris par de nombreuses études. Ainsi, les deux tiers des étudiants des grandes écoles sont issus des catégories sociales très favorisées, 9% proviennent des classes défavorisées 1. La fiche “24. le niveau d’études selon le milieu social” confirme l’écart entre les enfants de cadres, de professions intermédiaires ou d’indépendants et ceux d’ouvriers ou d’employés à l’heure d’accéder aux diplômes supérieurs2. Ces chiffres questionnent la possibilité de mobilité sociale à l’aune du mérite et nous invitent à nous interroger sur la méritocratie : serait-elle un facteur de renforcement des inégalités ?
Reconnaissance et dignité du travail : des parcours atypiques peu considérés
En tant que cheffe d’entreprise, autodidacte, noire, étrangère, qui n’a jamais fait d’études et qui pourtant a « réussi », j’observe une grande prudence quand je pense la méritocratie. Je suis en faveur de celle-ci à condition qu’elle ne soit ni définie, ni limitée, par des succès académiques, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, nombreux et surtout nombreuses sont celles autour de moi qui ont connu une forme de discrimination du fait de ne pas avoir fait une grande école ou bien d’avoir un parcours atypique. « Si les candidats ne viennent pas de telle ou telle école…alors ce n’est même pas la peine qu’ils postulent chez nous » entend-on dans un salon de recrutement. « Mais vous avez fait Sciences Po ? » me demande-t-on, surpris par la négative. Ce qui est valorisé par les héritiers est moins la volonté, l’effort, les compétences et la capacité de travail des candidats et des candidates, que leur parcours académique et une trajectoire normée. Dès lors, on peut raisonnablement douter que la diversité sociale soit dans les faits vue comme une force. Le diplôme est un marqueur sur le marché du travail, mais il est également un instrument de reconnaissance entre des pairs aux origines sociales et géographiques plutôt homogènes. Ce faisant, il se transforme donc en un a priori qui ne laisse pas sa chance aux profils plus atypiques par leur éducation, leurs expériences et/ou leurs origines. La méritocratie est alors contre-productive, au lieu de servir la mobilité sociale, elle l’asservit, au lieu d’encourager l’égalité des chances, elle favorise la reproduction des élites, qui pensent être là du fait même de leur mérite !
Faire confiance au travail pour sortir de l’impasse méritocratique
Pour atteindre une véritable inclusion et une société plus juste, il faut que l’on donne sa chance à tous par le travail, c’est-à-dire laisser la possibilité aux personnes de faire leurs preuves, plutôt que de nous reposer sur nos préjugés de classe, d’études, de race etc.
Pour ce faire, je distingue à partir de mon expérience professionnelle deux facteurs clés. Un qui dépend de moi, le travail et l’effort que j’ai mis en oeuvre aussi bien en tant que femme de ménage qu’à la mairie de Paris.
Un autre, qui est la confiance qui m’a été accordée par mes différents employeurs, confiance fondée sur la reconnaissance de mes compétences et de mes capacités, malgré mon absence de diplômes.
Ces deux composantes me semblent généralisables et elles peuvent répondre aux limites de la méritocratie en remettant sur le devant de la scène la valeur et la dignité du travail. Il n’y a ni sot métier, ni sot diplôme, mais il y a la volonté ou non d’encourager les personnes pour ce qu’elles apportent, par-delà leur éducation. En tant qu’employeur, il s’agit dès lors d’être dans une posture où l’on juge des compétences plus que des parcours.
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons trouver un équilibre, déconstruire les freins, et redéfinir la méritocratie : une reconnaissance du travail avec ou sans diplôme. A cet égard, l’élection de Joe Biden, premier Président démocrate américain non-issu des Ivy Leagues, est porteur d’espoir. Dans son discours, il insiste moins sur la concurrence méritocratique que sur la reconnaissance et la dignité du travail : ce sont certainement des valeurs qu’il nous faut réactualiser dans les débats à venir.
1 « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? », Rapport n° 30, Institut des politiques publiques, janvier 2021
2 En moyenne, sur la période 2017-2019, chez les jeunes âgés de 25 à 29 ans, 63 % des enfants de cadres, de professions intermédiaires ou d’indépendants sont diplômés du supérieur, contre 32 % des enfants d’ouvriers ou d’employés. Source : Insee (enquête Emploi), traitements MENJS-MESRI-DEPP
Reconnaissance et dignité du travail/Reconnaissance et dignité du travail